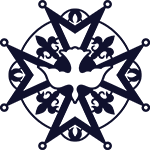Trinity Sunday
June 15, 2025
Proverbs 8:1-4; 22-31 Romans 5:1-5 John 16:12-15
You have heard me speak about the 400th anniversary of Saint-Esprit in 2028; but this year, all Christian churches are celebrating a major anniversary: the 1700th anniversary of the Council of Nicaea. Every Sunday, we confess our faith with the words of this council—slightly amended by a later council—when we recite, along with many other Christian churches, the Nicene Creed. At the invitation of the Roman emperor Constantine in 325, around 300 bishops from the Eastern and Western Churches gathered in the city of Nicaea, in present-day Turkey. It was something new and extraordinary to bring the leaders of the Churches together in this way, when only a few years earlier the Jesus movement was still persecuted by these same imperial authorities. Some bishops present even bore the marks of torture on their bodies. The purpose of this assembly was to overcome the divisions and conflicts that had arisen among Christians, particularly around the nature of Christ. Is Christ God from all eternity, like the Father, or was he created by God in time? Is the Son inferior and subordinate to the Father? While these questions may seem abstract or purely doctrinal today, they touch on the heart of our understanding of God—not only in himself, but especially in the many ways that we believe God is reflected in our lives.
Today, we remember that the God in whom we believe, whom we call upon in prayer, whom we encounter in Scripture, liturgy, and creation, reveals himself above all as a mystery: what theologians, since the African Tertullian, have called the Trinity. Although there are three equal persons—the Father, the Son, and the Holy Spirit—the Church believes that God is one and the same divine reality, a truly united triad: one God. We are sometimes so “used to” this Trinitarian formula that we no longer pay attention to it. And yet, this faith is subversive, deeply countercultural. In the Gospel according to John, just before his passion, Jesus speaks to his disciples about the coming of the Spirit. By doing so, he also reveals the intimate relationship of co-dependence and love that unites him to the Father and the Spirit: “[The Spirit],” he says, “will not speak on his own, but will speak whatever he hears, and he will declare to you the things that are to come. He will glorify me, because he will take what is mine and declare it to you. All that the Father has is mine. For this reason I said that he will take what is mine and declare it to you.” The God whom Jesus reveals through his life, death, and resurrection is not static and individualistic, concerned only with his own preservation. He is not the distant and impassive God of philosophers or abstract theism. God defines himself by the fact that he gives himself, that he loves. This is his profound identity. If we see in God a fixed, impenetrable unity, we are mistaken not only about who God is, but also about who we are and what we are called to be.
In the account of the creation of human beings in the Book of Genesis, God says, “Let us make humans in our image, according to our likeness.” This likeness is that of the love shared between the Father, the Son, and the Holy Spirit. It is this creative love that sustains all creation. But it also sustains our communities, and even our souls, in the very life of God. It is therefore not surprising that many authoritarian and fanatical political or religious movements are perfectly comfortable with a rigid theism. God becomes an authoritarian father figure and the guarantor of an established and unquestionable order. Many Christians—especially in the United States—are more theistic than Trinitarian. Yet modeling our lives on a God who is both one and three, in communion of love, compels us to resist our tendency to construct identities that are proud of their power, compartmentalized in their independence, and ready to dominate and subordinate others.
Living in the image of the Trinity prevents us from taking refuge in “pure” and “untouchable” postures or identities, whether national, racial, or communal. It also means understanding that attitudes of intimidation and subordination are not in the image of God, in whom the different persons of the Trinity are equal and listen to one another. What the relationship of love between the divine persons reveals to us—a relationship in which we participate in liturgy, prayer, and contemplation—is that for the Church the path of life for our nations, for our souls, is a path that makes room for the other, the other who is also ourselves. It is a path of life that runs counter to the powers of this world. This Trinitarian way of living is not natural to us, even to our natural “religiosity.” But it is nevertheless the way of true life: that of a trusting abandonment to the love that created us and, through Christ Jesus, wants constantly to remake us in his image by revealing to us the infinite compassion and tenderness of God, the source of all life. We do not need to cling to identities, ideas, or narrow values to live the greater life of God. We enter the mystery of the divine Trinity when we recognize all that binds us together and when we ourselves become weavers of bonds. We enter the mystery of the Trinity when we care for and defend the precious and mysterious bonds of love and communion that weave our communities, our city, our nations, and our environment.
After the service, we will have one of the many opportunities that daily life offers us to participate in this Trinitarian life by taking care of our little garden behind the church. A garden and all of creation constantly remind us of the mystery of communion, balance, and love, which alone can make all life flourish and our own grow. It is surely no coincidence that God placed the first humans there, formed in his Trinitarian image.
JFB
Dimanche de la Trinité 15 juin 2025 Proverbes 8:1-4; 22-31 Romains 5:1-5 Jean 16:12-15
Vous m’avez entendu parler des 400 ans de Saint-Esprit en 2028 mais cette année, toutes les Églises chrétiennes célèbrent un grand anniversaire : les 1700 ans du Concile de Nicée. Chaque dimanche, nous confessons notre foi avec les paroles issues de ce concile — légèrement amendées par un concile ultérieur — lorsque nous récitons, avec de nombreuses autres Églises chrétiennes, le Symbole de Nicée. En 325, à l’invitation de l’empereur romain Constantin, environ 300 évêques venus des Églises d’Orient et d’Occident se sont réunis dans la ville de Nicée, située dans l’actuelle Turquie. C’était quelque chose de nouveau et d’extraordinaire : réunir ainsi les responsables des Églises, alors que, quelques années plus tôt, le mouvement de Jésus était encore persécuté par ces mêmes autorités impériales. Certains évêques présents portaient d’ailleurs sur leur corps les marques des tortures subies. L’objectif de cette assemblée était de surmonter les divisions et les conflits qui avaient surgi parmi les chrétiens, en particulier autour de la nature du Christ. Le Christ est-il Dieu de toute éternité, comme le Père, ou a-t-il été créé par Dieu dans le temps ? Le Fils est-il inférieur et subordonné au Père ? Si ces questions peuvent aujourd’hui sembler abstraites ou purement doctrinales, elles touchent en réalité au cœur de notre conception de Dieu — non seulement en lui-même, mais surtout dans les multiples manières dont ce que nous croyons de Dieu se reflète en nos vies.
Aujourd’hui, nous nous souvenons en effet que le Dieu auquel nous croyons, que nous invoquons dans la prière, que nous rencontrons dans les Écritures, la liturgie et la création, se révèle avant tout comme un mystère : celui que les théologiens, depuis l’Africain Tertullien, appellent la Trinité. L’Église croit que, bien qu’il soit trois personnes égales — le Père, le Fils et le Saint-Esprit — Dieu forme une seule et même réalité divine, une triade véritablement une : un seul Dieu. Nous sommes parfois tellement « habitués » à cette formulation trinitaire que nous n’y prêtons plus attention. Et pourtant, cette foi est subversive, profondément contre-culturelle. Dans l’Évangile selon Jean, juste avant sa passion, Jésus parle à ses disciples de la venue de l’Esprit. Et ce faisant, il révèle aussi la relation intime, de co-dépendance et d’amour, qui l’unit au Père et à l’Esprit : « [L’Esprit] » dit-il « ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu’il aura entendu et il vous annoncera ce qui doit arriver. Il manifestera ma gloire, car il recevra de ce qui est à moi et vous l’annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. C’est pourquoi j’ai dit que l’Esprit recevra de ce qui est à moi et vous l’annoncera. » Le Dieu que Jésus révèle par sa vie, sa mort et sa résurrection n’est pas statique et individualiste, soucieux de sa seule préservation. Il n’est pas le Dieu lointain et impassible des philosophes ou du théisme abstrait. Ce qui définit Dieu, c’est qu’il se donne, qu’il aime. Telle est son identité profonde. Si nous voyons en Dieu une unité figée, impénétrable, nous nous trompons non seulement sur qui est Dieu, mais aussi sur qui nous sommes, et sur ce à quoi nous sommes appelés.
Dans le récit de la création de l’être humain, au livre de la Genèse, Dieu dit : « Faisons l’être humain à notre image, selon notre ressemblance ». Cette image, c’est celle de l’amour partagé entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C’est cet amour créateur qui soutient toute la création, mais aussi nos communautés, et même nos âmes, dans la vie même de Dieu. Il n’est donc pas étonnant que beaucoup de mouvements politiques ou religieux autoritaires et fanatiques s’accommodent parfaitement d’un théisme figé, où Dieu, figure paternelle autoritaire, devient garant d’un ordre établi et incontestable. Nombre de chrétiens — notamment aux États-Unis — sont davantage théistes que trinitaires. Pourtant, modeler notre vie sur un Dieu qui est à la fois un et trois, en communion d’amour, nous oblige à résister à notre tendance à construire des identités fières de leur pouvoir, cloisonnées dans leur indépendance et prêtes à dominer et subordonnés les autres.
Vivre à l’image de la Trinité, nous empêche de nous réfugier dans des postures ou des identités « pures » et « intouchables », qu’elles soient nationales, raciales ou communautaires. C’est aussi voir que les attitudes d’intimidation, de subordination ne sont pas à l’image de Dieu, en qui les différentes personnes de la Trinité sont égales et à l’écoute les unes des autres. Ce que nous révèle la relation d’amour entre les personnes divines — relation à laquelle nous participons dans la liturgie, la prière, la contemplation — c’est que le chemin de la vie, pour l’Église, pour nos nations, pour nos âmes, est un chemin qui fait de la place pour l’autre, l’autre qui est aussi nous-mêmes. C’est un chemin de vie qui prend le contre-pied des pouvoirs de ce monde. Cette manière trinitaire de vivre n’est pas naturelle pour nous, même pour notre « religiosité » naturelle. Mais c’est pourtant la voie de la vraie vie : celle d’un abandon confiant à l’amour qui nous a créés, et qui, par le Christ Jésus, veut constamment nous remodeler à son image en nous révélant l’infinie compassion et tendresse de Dieu, source de toute vie. Nous n’avons pas besoin de nous accrocher à des identités, à des idées ou à des valeurs bornées pour vivre la vie plus grande de Dieu. Nous entrons dans le mystère de la Trinité divine quand nous reconnaissons tout ce qui nous lie et quand nous devenons nous-mêmes tisseurs et tisseuses de liens. Nous entrons dans le mystère de la Trinité quand nous prenons soin et défendons les liens précieux et mystérieux d’amour et de communion qui tissent nos communautés, notre ville, nos nations et notre environnement.
Après le service, nous aurons une occasion, parmi les nombreuses que le quotidien nous donne, de participer à cette vie trinitaire en prenant soin de notre petit jardin à l’arrière de l’église. Un jardin et toute la création, nous rappelle constamment au mystère de communion, d’équilibre et d’amour qui seul peut faire fleurir toute vie et faire grandir la nôtre. Ce n’est sans doute pas un hasard que Dieu y a placé les premiers humains, formés à son image trinitaire.
JFB