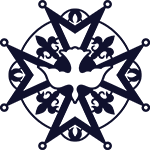Pentecost V (Bastille Day)
July 13, 2025
Amos 7:7-17 Colossians 1:1-14 Luke 10:25-37
I have never liked flags in churches, or even in front of churches. And I am very happy that when Nigel arrived at St. Esprit, he put ours away in the basement! Patriotism always seems out of place in a church to me. Flags are symbols of tribal, military, emotional, community, and ideological allegiance. They’re amusing at best for sports games or celebrations, as long as they’re not used to exclude people but rather to remind them of an innocuous attachment to a culture. But in or in front of a church, they suggest that the church itself subscribes to that ideology, or that a form of belonging is expected there. Personally, it was by becoming a stranger that I could best understand the Gospel. So, understand my embarrassment at having to preach on a Sunday followed by a reception for July 14, France’s national holiday; when everyone expects me to talk about it!
I don’t think I’m the only one uncomfortable with a certain idea of patriotism at Saint-Esprit. We are probably one of the most international congregations in New York. This discomfort with the demands of patriotism was also shared by the Huguenots who founded our church. Like us, they often suffered from national, linguistic, and religious boundaries, often falling, like us, between the cracks. Not considered “good Catholics,” they were persecuted, imprisoned, subjected to arbitrary detention and forced labor. Like some people who are not considered fully American today, some Huguenots (such as our revered Elias Neau) were also imprisoned in state prisons such as the Bastille. Clearly defined community identities are tools of control, and the Bastille, in 1789, was the embodiment of this. It is this Bastille whose storming and dismantling the French—and, to some extent, we today—celebrate.
It is nothing new that the political or religious establishment is irritated by or distrustful of anything that does not fit into its categories. In today’s Gospel, this irritation is expressed by a lawyer. At first, everything goes well. He knows the right principles: love God, and your neighbor as yourself. But principles are easy to state and parade around—like “Liberté, Égalité, Fraternité” on the façades of town halls in France; or what is now called “virtue signaling,” – an American specialty that is difficult to translate into French! Jesus, on the other hand, does not lead us to eternal ideas, but to eternal life. And that is where the problem lies. The lawyer, like all gatekeepers of identity, wants clear, hierarchical, exclusive categories. He wants a list, a definition. But Jesus tells a story. He does not tell us who our neighbor is: he shows us how to become a neighbor. He provokes a revolution in the way we belong to God and to others, a revolution that does not begin with identities or abstract principles. Jesus shows that eternal life is not a matter of definition, but of relationship, attention, love, compassion, and sacrifice. This is a quiet but radical revolution that exposes the hypocrisy of fixed identities. The model of eternal life is not the self-assured lawyer, the good patriot, or the smug Christian. It is someone who acts with kindness, regardless of their identity, even the most unlikely! The Jews considered the Samaritans to be heretics and pagans. They were descendants of the northern tribes of Israel, had married foreigners, and practiced a rival form of Judaism. Jesus shows that eternal life is not won through battles over identity or belonging, but through kindness.
And this revolution does not have a flag or a principle as its banner, but the cross. That is why, at the beginning of the service, you may have been surprised to hear the notes of the Marseillaise merge into a hymn to the cross, a hymn that also says that “Victory is possible for those who fight on their knees.” It is by kneeling, by stepping down from our egos, that we enter into a brotherhood deeper than any political or religious bond. The crosses we embrace break all of that down. St. John Chrysostom wrote that Christ, in embracing the cross, not only “opened the bronze doors, but broke them down, so that the prison became useless […] for a prison without doors or hinges cannot hold anyone.” The way of Jesus, our path to Jericho, does not free us by opening the doors of prisons: it demolishes them. Jesus, together with those who do act kindly, storms the Bastille of our hearts, our confinements, our systems of domination, our borders, our hierarchies.
What has become of the stones of the Bastille? They were used to build the Bridge of the Concorde, which crosses the Seine in the heart of Paris. Legend has it that this was done so that “the people could continually trample on the ancient fortress.” The fate of the Bastille reflects that of the cross of Jesus, which transforms places of confinement into places of passage and life. It builds bridges. It connects us. Our crosses, reflections of that of Jesus, make us recognize our common humanity, our brotherhood. It is through them that our lives converge here, at this altar where we come to worship Jesus in the sacrament of his body and blood, broken and poured out for us. Our crosses are the plumb line that helps us build the Kingdom of God, visible in our communities, of which each of us is a living stone.
Since Pentecost, I have had the honor of getting to know Gergő and Nora better, who are about to be baptized and confirmed. During our Monday preparation dinners, I discovered with wonder how your journeys, guided by God, have brought you to this unusual little French-speaking church, even though you are neither French nor Huguenots. Your family, professional, and spiritual journeys speak for themselves, like our parable: Christ has called you to cross cultural and religious boundaries with tact and generosity, out of love for God and your neighbors. You have experienced being a stranger, and you have supported strangers. I must also say that you, Nora, an immigration lawyer, and you, Gergő, an international lawyer, are both restoring the image of lawyers after that incriminating Gospel passage! Today, the Church rejoices because the Good News is alive in you. Your faithfulness to Christ strengthens us, especially in times of fear and withdrawal. By plunging or replunging into the waters of baptism here in this old church, you are reviving our faith, our hope, and our common mission. And you will never be alone. Here you have brothers and sisters with whom to tread the stones of our common and contemporary Bastilles, and to pass with you into the eternal life to which Christ calls us.
JFB.
Pentecôte V (Bastille Day) 13 juillet 2025 Amos 7:7-17 Colossiens 1:1-14 Luc 10:25-37
Je n’ai jamais aimé la présence de drapeaux dans les églises, ni même devant les églises. Et je suis très heureux que, quand il est arrivé, Nigel les a remisés à la cave ! Le patriotisme me semble toujours déplacé dans une église. Les drapeaux sont des symboles de ralliement tribal, militaire, émotionnel, communautaire et idéologique. Amusants à la limite pour les matchs ou les fêtes, tant qu’ils ne servent pas à exclure mais rappellent un attachement bon enfant à une culture. Mais dans ou devant une église, ils suggèrent que l’église elle-même y adhère, ou qu’on y attend une forme d’appartenance. Personnellement, c’est en devenant étranger que j’ai le mieux compris l’Évangile. Alors comprenez mon embarras de devoir prêcher un dimanche suivi d’une réception pour le 14 juillet, fête nationale française, alors que tout le monde attend que j’en parle !
Je ne pense pas être le seul mal à l’aise avec une certaine idée du patriotisme à Saint-Esprit. Nous sommes probablement l’une des congrégations de New York les plus internationales. Cet inconfort avec les exigences du patriotisme était aussi partagé par les Huguenots qui ont fondé notre Église. Comme nous, ils ont souvent souffert des frontières nationales, linguistiques, confessionnelles, tombant souvent, comme nous, entre les lattes du plancher. N’étant pas considérés comme de « bons sujets catholiques », ils ont été persécutés, emprisonnés, soumis à la détention arbitraire et au travail forcé. Comme certaines personnes qui ne sont pas considérées comme pleinement américaines aujourd’hui, certains huguenots (comme notre vénéré Elias Neau) ont aussi été emprisonnés dans des prisons d’État telles que la Bastille. Les identités communautaires bien délimitées sont des outils de contrôle et la Bastille, en 1789, en était l’incarnation. C’est cette Bastille dont les Français (et nous, un peu aujourd’hui) célébrons la prise et le démantèlement.
Il n’est pas nouveau que l’establishment, politique ou religieux, s’agace ou se méfie de ce qui échappe à ses catégories. Dans l’Évangile d’aujourd’hui, ce rôle est joué par le spécialiste de la Loi. Au départ, tout se passe bien. Il connaît les bons principes : aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Mais les principes sont faciles à énoncer et à parader — comme liberté, égalité, fraternité sur le fronton des mairies en France, ou ce qu’on appelle aujourd’hui le virtue signaling, spécialité américaine qui se traduit mal en français ! Jésus, lui, ne nous conduit pas à des idées éternelles, mais à la vie éternelle. Et c’est là que le bât blesse. Le juriste, comme tous les chiens de garde des identités, veut des catégories claires, hiérarchisées, excluantes. Il veut une liste, une définition. Mais Jésus raconte une histoire. Il ne dit pas qui est notre prochain : il montre comment devenir un prochain. Il provoque une révolution dans notre façon d’appartenir à Dieu et aux autres, une révolution qui ne commence pas par des identités ou des principes abstraits. Jésus montre que la vie éternelle n’est pas affaire de définition, mais de relation, d’attention, d’amour, de compassion et de sacrifice. Voilà une révolution discrète mais radicale, qui expose l’hypocrisie des identités figées. Le modèle de la vie éternelle, ce n’est pas le juriste sûr de lui, ni un bon patriote, ni un chrétien suffisant. C’est quelqu’un qui agit avec bonté, quelle que soit son identité, même la plus improbable ! Les Juifs considéraient en effet les Samaritains comme des hérétiques et des païens. Ils étaient les descendants des tribus du nord d’Israël, s’étaient mariés avec des étrangers et pratiquaient une forme de judaïsme rival. Jésus montre que l’on ne gagne pas la vie éternelle par des batailles d’identités ou d’appartenance, mais par la bonté.
Et cette révolution n’a pas pour bannière un drapeau ou un principe, mais la croix. C’est pour ça qu’au début du service, vous aurez peut-être été surpris d’entendre les notes de la Marseillaise se fondre en un hymne sur la croix, un hymne qui dit aussi que « le triomphe est possible pour qui lutte à genoux ». C’est en nous mettant à genoux, quand nous descendons de nos égos, que nous entrons dans une fraternité plus profonde que tout lien politique ou religieux. Les croix que nous embrassons brisent tout cela. Saint Jean Chrysostome écrivait d’ailleurs que le Christ, en embrassant la croix, n’a pas seulement « ouvert les portes d’airain, mais les a brisées, afin que la prison devienne inutile […] car une prison sans portes ni gonds ne peut retenir personne. » La voie de Jésus, notre chemin de Jéricho, ne nous libère pas en ouvrant les prisons : elle les démolit. Jésus prend avec les bons d’assaut la Bastille de nos cœurs, nos enfermements, nos systèmes de domination, nos frontières, nos hiérarchies.
Que sont devenues les pierres de la Bastille ? Elles ont été utilisées pour construire le pont de la Concorde qui traverse la Seine au cœur de Paris. La légende veut que ce soit pour « que le peuple puisse continuellement fouler aux pieds l’antique forteresse ». Ce destin de la Bastille reflète celui de la croix de Jésus, elle qui transforme les lieux d’enfermement en lieux de passage et de vie. Elle qui jette des ponts. Elle qui nous relie. Nos croix, reflets de celle de Jésus, nous font reconnaître notre humanité commune, notre fraternité. C’est par elles que nos vies convergent ici, à cet autel où nous venons adorer Jésus dans le sacrement de son corps et de son sang, rompu et versé pour nous. Nos croix sont le fil à plomb qui nous aide à bâtir le Royaume de Dieu, visible dans nos communautés, et dont chacun de nous est une pierre vivante.
Depuis la Pentecôte, j’ai eu l’honneur de mieux connaître Gergő et Nora, qui vont être baptisés et confirmés dans un instant. Lors de nos dîners de préparation du lundi, j’ai découvert avec émerveillement comment vos parcours, conduits par Dieu, se sont retrouvés dans cette insolite petite église francophone, alors que vous n’êtes ni français, ni huguenots. Vos parcours familiaux, professionnels, spirituels parlent d’eux-mêmes, comme cette parabole : le Christ vous a appelés à traverser des frontières culturelles et religieuses, avec tact et générosité, par amour pour Dieu et vos prochains. Vous avez vécu l’expérience de l’étranger, et vous avez soutenu des étrangers. Je dois aussi dire que toi, Nora, avocate en immigration, et toi, Gergő, juriste en droit international, vous redorez tous les deux l’image des juristes après cet évangile à charge ! Aujourd’hui, l’Église se réjouit car la Bonne Nouvelle est vivante en vous. Votre fidélité au Christ nous fortifie, surtout dans des temps de peur et de repli. En plongeant ou replongeant dans les eaux du baptême, ici, dans cette vieille église, vous ravivez notre foi, notre espérance et notre mission commune. Et vous n’y serez jamais seuls. Vous avez ici des frères et sœurs avec qui fouler les pierres de nos Bastilles présentes et communes et passer avec vous dans la vie éternelle à laquelle le Christ nous appelle.
JFB