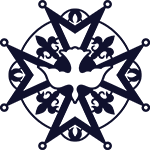Pentecost III
June 29, 2025
2 Kings 2:1-2, 6-14 Galatians 5:1, 13-25 Luke 9:51-62
We have all experienced pain or shame related to our bodies. Due to the judgments we make about ourselves and the judgments society makes about us, it is often our physical appearance or mannerisms that cause us to feel ashamed. Our weight, height, age, skin color or complexion, gender expression that may or may not conform to expectations: all of these things have been, or often still are for us (even if we don’t want to think it), the source of feelings of shame, occasions for regret, or desires to be different. Just behind this very wall (perhaps at this very moment!) this is surely part of what keeps Dr. Levine busy; our neighbor and a plastic surgeon! It is on our bodies, and those of others, that we pass judgment. And some would say that Christian morality is the cause. A certain “Christian” morality, certainly. Indeed, if a movie wants to portray a Christian preacher in a wig in a period film, it’s a safe bet that the screenwriter will have him preach a fiery sermon against the flesh. Few concepts in Christian theology are as loaded and evocative of moral judgment, shame, and condemnation as that of “the flesh.” Few terms are unfortunately as misunderstood and have caused as many serious misunderstandings.
Traditionally, the term “flesh” (la chair) translates the Greek word σάρξ (sarx) that Paul uses here in his letter to the Galatians. Our French translation of the Bible, known as the Nouvelle Français courant, published in 2019, rightly distances itself from the moralizing connotations that surround this word. It translates sarx as “human inclinations.” Paul says, “Do not use your freedom” acquired through Christ “as a pretext for living according to your human inclinations.” Contrary to what certain outdated devotions and poor theologies of the “flesh” would have us believe, the Christian faith is not against the body. Quite the contrary!
No one has ever lived a life as incarnate as God himself, who “took flesh from the Virgin Mary and became human.” Through the Holy Spirit, and through his mother, Jesus took flesh in and from us, and this is how he leads us to a greater life. It is by inhabiting, like us, the painful and shameful experience of his own body that Jesus also teaches us to inhabit our own, in order to lead us to this greater life. Nothing is more incarnate than holiness, and there is no other path to holiness than that which passes through our bodies, the whole of our bodies. No one grows in holiness by living in denial of our incarnate nature, which is also expressed through our desires and our sexuality and through the difficulties that sometimes arise from them. Jesus says this in today’s Gospel, in a verse that is missing from some manuscripts: “The Son of Man did not come to destroy human lives, but to save them.” (Luke 9:56). The incarnation of Jesus does not consist in wiping out what we are, but in making us live precisely through the incarnation.
What about, you may ask, debauchery, idol worship and magic, quarrels, jealousy, anger… orgies, etc. or a punch in the face? Perhaps these things are not incarnate? Well, no, precisely: these things, which sometimes seem to us to be the most “incarnate,” are in fact the least free, the least generous, the least alive realities. Human inclinations produce addictions, defensive reactions, divisions, and even despair: all of this, like the sterile polemics we see everywhere today, is anything but creative, joyful, or new. As the French philosopher Simone Weil wrote: “Imaginary evil is romantic, varied; real evil is dull, monotonous, desert-like, boring.” But she also wrote that “real good is always new, wonderful, inebriating.” And this is the very nature of the gifts of the Spirit that Paul describes: these gifts are truly embodied—therefore free, even physically free, and creative. It is to this new, wonderful, and intoxicating life that we are called—body and soul, entirely. And this call is nothing other than an invitation to a feast, the feast of communion that we receive from our Lord, right here, every time we recognize ourselves as members of his living body. It is through his body that the Lord Jesus wants to have his life come into our lives.
If the call to follow and serve Christ is demanding and costly, it is not because he asks us to flee our incarnate reality, but because he calls us to live it fully, in truth, with vulnerability and courage. He asks us to leave behind the security of our disguises, our positions, our prefabricated social roles, our fears of not being good enough. He calls us to renounce the too-human demands we place on others and ourselves, to recognize that our freedom is not found in separation, purity, or judgment, but in love—a costly, holy love that binds us to God, to creation, and to one another.
This is the way of the Spirit, which we follow during this season of Pentecost. This way leads us to explore the greatness and depth of our communion: with Jesus, with the Church, with our neighbors, with ourselves. The way of the Spirit reminds us, at every Eucharist, that we are members of the Body of Christ—not the whole, not the head, not the king, but living stones in a holy city that we do not build ourselves. No morality, no ideology (whether conservative or progressive) can accomplish this. Only daily, ordinary, sometimes painful surrender to the presence of Christ in our bodies, our relationships, and our world can lead us to this true freedom. So let us live our incarnation, here, in this city, in this community, in this world, without fear, without limits, strengthened by the Holy Spirit who has called us.
JFB.
Pentecôte III 29 juin 2025 2 Rois 2:1-2, 6-14 Galates 5:1, 13-25 Luc 9:51-62
Nous avons tous fait l’expérience douloureuse ou honteuse de nos corps. C’est souvent notre physique ou nos manières qui ont fait naître en nous, à cause du jugement que nous portons sur eux et que la société porte sur nous, des sentiments de honte. Notre poids, notre taille, notre âge, la couleur ou la qualité de notre peau, notre expression de genre plus ou moins conforme à ce qu’on attend : tout cela a été, ou est encore souvent pour nous (même si nous ne voulons pas y croire), à l’origine de sentiments de honte, d’occasions de regrets ou de désirs d’être différents. C’est sûrement en partie cela qui, juste derrière ce mur (peut-être à l’instant même !) donne du travail au Dr Levine, notre voisin et chirurgien esthétique ! C’est sur nos corps, et ceux des autres, que porte notre jugement. Et certains diront que la morale chrétienne en est la cause. Une certaine morale « chrétienne », sûrement. En effet, si le cinéma veut représenter un prédicateur chrétien en perruque dans un film historique, il y a fort à parier que le scénariste le fera prêcher un sermon enflammé contre la chair. Peu de concepts de la théologie chrétienne sont aussi chargés et évocateurs de jugement moral, de honte et de condamnation que celui de « la chair ». Et peu de termes malheureusement sont aussi mal compris et ont causé autant de graves malentendus.
Traditionnellement, le terme « chair » (flesh en anglais) traduit le mot grec σάρξ (sarx) que Paul utilise ici dans sa lettre aux Galates. Notre traduction de la Bible, dite Nouvelle Français courant publiée en 2019, prend à juste titre ses distances avec les connotations moralisatrices qui gravitent autour de ce mot. Elle traduit sarx par « penchants humains ». Paul dit en effet : « Ne faites pas de votre liberté » acquise par le Christ « un prétexte pour vivre selon vos penchants humains ». Contrairement à ce que peuvent faire croire certaines dévotions vieillottes et de mauvaises théologies de la « chair », la foi chrétienne n’est pas contre le corps. Bien au contraire !
Personne n’a jamais vécu une vie aussi incarnée que Dieu lui-même, qui « a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme ». Par le Saint-Esprit, Jésus a pris chair en et de nous, en sa mère, et c’est ainsi qu’il nous conduit dans une vie plus grande. C’est en habitant, comme nous, l’expérience douloureuse et honteuse de son propre corps que Jésus nous apprend aussi à habiter le nôtre, pour nous mener vers cette vie plus grande. Rien n’est plus incarné que la sainteté, et il n’y a pas d’autre voie vers la sainteté que celle qui passe par nos corps, tous nos corps. Personne ne grandit en sainteté en vivant dans le déni de nos natures incarnées, qui s’exprime aussi par nos désirs et nos sexualités et par les difficultés qu’ils sont parfois surgir. Jésus le dit dans l’évangile de ce jour, dans un verset absent de certains manuscrits : « Le Fils de l’homme n’est pas venu pour détruire les vies des humains, mais pour les sauver. » (Luc 9,56). L’incarnation de Jésus ne consiste pas à faire table rase de ce que nous sommes, mais à nous faire vivre justement par l’incarnation.
Qu’en est-il, me direz-vous, de « la débauche, le culte des idoles et la magie, les querelles, les jalousies, les colères… les orgies, etc. », ou d’un poing dans la figure ? Ce n’est pas incarné peut-être ? Eh bien non, justement : ces choses, qui nous semblent parfois les plus « incarnées », sont en fait les réalités les moins libres, les moins généreuses, les moins vivantes. Les penchants humains produisent des addictions, des réactions défensives, des divisions ou encore du désespoir : tout cela, comme les polémiques stériles qu’on voit aujourd’hui partout, est tout sauf créatif, joyeux ou nouveau. Comme l’écrivait Simone Weil, philosophe française : « le mal imaginaire est romantique, varié ; le mal réel est morne, monotone, désertique, ennuyeux. » Mais elle écrivait aussi que « le bien réel est toujours nouveau, merveilleux, enivrant ». Et c’est là le propre des dons de l’Esprit que Paul décrit : ces dons sont véritablement incarnés — donc libres, même physiquement libres, et créatifs. C’est dans cette vie nouvelle, merveilleuse et enivrante, que nous sommes appelés — corps et âme, entièrement. Et cet appel n’est autre qu’une invitation à un repas de fête, celui de la communion que nous recevons de notre Seigneur, ici même, et chaque fois que nous nous reconnaissons comme membres de son corps vivant. C’est par son corps que le Seigneur Jésus veut faire venir sa vie dans nos vies.
Si l’appel à suivre et à servir le Christ est exigeant et coûteux, ce n’est pas parce qu’il nous demande de fuir notre réalité incarnée, mais parce qu’il nous appelle à l’habiter pleinement, dans la vérité, avec vulnérabilité et courage. Il nous demande de quitter la sécurité de nos déguisements, de nos positions, de nos rôles sociaux préfabriqués, de nos peurs de ne pas être à la hauteur. Il nous appelle à renoncer aux exigences trop humaines que nous imposons aux autres et à nous-mêmes, pour reconnaître que notre liberté ne se trouve pas dans la séparation, la pureté ou le jugement, mais dans l’amour — un amour coûteux, saint, qui nous lie à Dieu, à la création et les uns aux autres.
C’est là le chemin de l’Esprit, que nous empruntons en ce temps de Pentecôte. Ce chemin nous conduit à explorer la grandeur et la profondeur de notre communion : avec Jésus, avec l’Église, avec nos prochains, avec nous-mêmes. Le chemin de l’Esprit nous rappelle, à chaque eucharistie, que nous sommes membres du Corps du Christ — non pas le tout, non pas la tête, non pas le roi, mais des pierres vivantes dans une cité sainte que nous ne construisons pas nous-mêmes. Aucune morale, aucune idéologie (qu’elle soit conservatrice ou progressiste) ne peut accomplir cela. Seule la reddition quotidienne, banale, parfois douloureuse, à la présence du Christ dans nos corps, nos relations et notre monde peut nous conduire à cette véritable liberté. Alors vivons notre incarnation, ici, dans cette ville, dans cette communauté, dans ce monde, sans peur, sans limites, forts de l’Esprit Saint qui nous a appelés.
JFB.