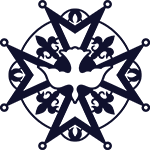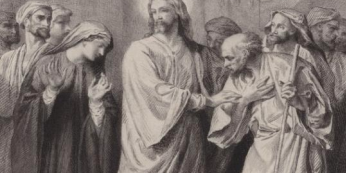Pentecost XXIII
November 16, 2025
Isaiah 65:17-25 ; II Thessalonians 3, 6-13 ; Luke 21:5-19
The French and American social security and welfare systems were created in the wake of enormous crises: situations that were nothing short of apocalyptic. The family, social, political, and economic devastation of the Great Depression prompted President Roosevelt to sign the Social Security Act in 1935, which was subsequently expanded by both Democratic and Republican presidents. In France, this year marks the 80th anniversary of social security. It was set up by French people who had resisted fascism, communists, centrists, and Gaullists. It provides all citizens with protection and support during the major stages and hardships of life (illness, maternity, disability, old age, death), according to the principles of universality, unity, and solidarity. These systems of economic solidarity were established thanks not only to unionist and political struggles, but also as a result of the greatest crises that the United States and France had ever experienced, periods during which their entire political, social, and economic systems were in ruins.
As crazy as it seems, Jesus reminds us today that times of crisis, those moments when we see our temples collapsing—like these, or our own times—should not become moments of anguish but moments of witness and communion. Easy to say, you might say, and I imagine the disciples thought the same thing. Having been on medication for anxiety for 10 years myself, I know that positive thoughts are not enough to free oneself from anxiety. Anxiety entangles our whole being like the serpent in Genesis: it slips between our thoughts, corrupts our judgment, transforms our perception, destroys the trust we place in ourselves and in others, magnifies the futile and the malicious, and diminishes the essential; the marks of love and kindness. It makes Satan immense and God very small. In fact, anxiety is anything but contemplation of God, because we look at ourselves or feed on “things.” The French language reflects this experience through the use of reflexive verbs: “on s’inquiète” (we worry ourselves), “on s’effraye” (we frighten ourselves)… We look at ourselves. We take elements of our experience and our analyses to feed internal nightmares that lead us to despair. It is anxiety that also feeds conspiracy theories, speculations about the signs of the end times, and all the injustices against which Jesus and Paul warn us in our readings today. All these anxious speculations have one thing in common: they distract us from our relationship with God in Jesus Christ. They make us forget that the one who tells us not to worry (just before his trial and condemnation) is the one who himself faced the anguish of the Garden of Gethsemane where he was captured for us.
These moments of testing are the moments when we must especially hold fast, for they are like gateways to a new reality. As we pass through them, we cannot cling to the bad news or the evil actions we see; or these same perceptions and realities will become idols or “gods” that have power over us. All the authorities, ideologies, and psychological, political, or economic attitudes that invite us to become gratified or complacent followers lead us astray and lord it over us. They usurp the name, power, and glory of God and dehumanize us. Jesus warns us against them when he says, “Many will come in my name and say, ‘I am he, and the appointed time has come,’” which in Greek is ego eimi, “I Am,” the way God himself presents himself.
In the face of anxiety, Jesus reminds us not to place our trust in our own judgment or in the signs we think we perceive. An unfortunate example of this attitude can be found in Paul’s letter to the community in Thessalonica, which he himself founded. In this community, some had abandoned their faith in the gospel and their responsibilities to the community, thinking that the end times had already come for them. They stopped working and engaging with others because they made their present situation an end in itself. They unilaterally judged that they no longer had any responsibility toward others and toward the community, because in a sense, everything was accomplished and fulfilled for them. The irony here is that this passage, which is often used by opponents of solidarity systems such as Social Security, is in fact a correction of those who believe they no longer need to work for the community and others unless it is to make decisions for themselves . Paul’s rebuke denounces a situation that is in every way similar to the plutocracy in which we live. A minority of people and corporations, who avoid taxes through tax schemes or concealment and who therefore refuse to participate in national solidarities, are none other than those who make political and social decisions for society as a whole. The Greek word Paul uses to describe the attitude of those who might well be called profiteers is periergázomai, meaning those who “work around”: they work, manipulate others and society, and are obsessed with what others do or do not do, but do not themselves work for the Kingdom. Faced with these abuses, Paul invites the Church of Thessalonica and all of us to participate in the work and labor of Christ, which is very different from the structures of work and the inequalities in our society. If we join in this work, this service, Paul tells us, (following Christ), and following Paul himself, we will gain food and life that will not perish; we will find a firm foundation for our lives.
We all tend to attribute too much power to our difficulties and our present circumstances. They are real, but they are less real than the power of Christ in which we participate. When I am enveloped in anxiety, I lose sight of God and the wonderful work he is doing in my life, in our world, and in our Church. We quickly forget that Jesus greatly needs us to participate in the work he has begun. The work to which God calls us is part of our human vocation: not only created in the image of God, but also redeemed in our humanity by him. Through our perseverance, we gain not only our salvation but also peace in this world. The word Paul uses when he speaks of “work” is the same word translated in Genesis as “keeping” the Garden, and also evokes worship in the temple. While the temple no longer exists but finds its new form in Jesus and in the dispersed Church, we are all invited to enter into communion with Christ wherever we are, so that the kingdom of God may come and the false economic, political, or religious idols that divide and dominate us may collapse. The work to which Christ calls us is not the work of the exploited, but a way, in our daily lives, of being formed in the one who accomplished our salvation through his perseverance.
It is to Jesus himself that we must hold fast. Resistance to anxiety and its reversal into hope come through our participation in Christ. Jesus lists signs of the end times, but insists: “Before all this,” the disciples must bear witness to him and participate in the coming of the Kingdom prophesied by Isaiah. How can we anchor ourselves in this model of Jesus and not in our personal or communal understandings, successes, or anxieties? By connecting ourselves to him through the Church and through service, what Paul calls “not be weary in doing what is right.” This begins with our attention to the communion we share in Christ—with God, with every human being, and with all creation. This is expressed in our service to others, here in our Church through volunteering, and in society by supporting any political action, such as Social Security, that aims to restore and preserve the dignity of each person.
Pentecôte XXIII 16 novembre 2025 Esaïe 65:17-25 ; II Thessaloniciens 3, 6-13 ; Luc 21:5-19
Les systèmes de solidarité et de sécurité sociale français et américains sont nés à la suite d’énormes crises, des situations tout bonnement apocalyptiques. Les ravages familiaux, sociaux, politiques et économiques de la Grande Dépression ont poussé, en 1935, le président Roosevelt à signer le Social Security Act, qui sera ensuite étoffé par des présidents américains, démocrates comme républicains. En France, on célèbre cette année les 80 ans de la Sécurité sociale. Elle a été imaginée par des Français ayant résisté au fascisme, communistes, centristes et gaullistes. Elle donne à tous les citoyens une protection et un accompagnement dans les grandes étapes et les coups durs de la vie (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès), selon des principes d’universalité, d’unité et de solidarité. Ces régimes économiques de solidarité ont été établis grâce à la lutte militante et politique, mais aussi à la faveur des plus grandes crises que les États-Unis et la France ont connues, périodes pendant lesquelles tout leur système politique, social et économique était à terre.
Aussi fou que cela puisse paraître, Jésus nous rappelle aujourd’hui que les situations de crise, ces moments où nous voyons nos temples s’effondrer — comme ceux-ci, ou comme notre époque — ne doivent pas devenir des moments d’angoisse mais des moments de témoignage et de communion. Facile à dire, me direz-vous, et j’imagine que les disciples ont pensé la même chose. Prenant moi-même des médicaments contre l’angoisse depuis 10 ans, je sais qu’une bonne pensée ne suffit pas à se dépêtrer de l’anxiété. L’anxiété enlace tout notre être comme le serpent de la Genèse : elle se glisse entre nos raisonnements, corrompt notre jugement, transforme notre perception, détruit la confiance que nous plaçons en nous-mêmes et dans les autres, grossit le futile et le malveillant, et rapetisse l’essentiel, les marques d’amour et de bonté. Elle rend Satan immense et Dieu tout petit. De fait l’anxiété est tout sauf la contemplation de Dieu, car on se regarde soi-même ou se nourrit de “choses”. La langue française reflète cette expérience par l’usage de verbes réflexifs : “on s’inquiète”, “on s’effraye”… On se regarde soi-même. On saisit des éléments de notre expérience et de nos analyses pour nourrir des cauchemars internes qui nous conduisent au désespoir. C’est l’inquiétude qui nourrit aussi les théories du complot, les spéculations sur les signes de la fin des temps, et toutes les injustices contre lesquelles Jésus et Paul nous mettent en garde dans nos lectures aujourd’hui. Toutes ces spéculations anxieuses ont une chose en commun : elles nous détournent de notre relation à Dieu, en Jésus Christ. Elles nous font oublier que celui qui dit de ne pas s’inquiéter (juste avant son jugement et sa condamnation) est celui qui lui-même qui a confronté l’angoisse du jardin de Gethsémani où il a été capturé pour nous.
Ces moments de test sont les moments où nous devons particulièrement tenir bon car ils sont comme des portiques vers une nouvelle réalité. En passant par eux, nous ne pouvons pas nous accrocher aux mauvaises nouvelles ou aux mauvaises actions que nous voyons ou alors ces perceptions et réalités dont nous faisons des idoles gagnent du pouvoir sur nous. Toutes les autorités, les idéologies et attitudes psychologiques, politiques ou économiques qui nous invitent à devenir des partisans satisfaits ou béats nous égarent et nous dominent. Elles usurpent le nom, le pouvoir et la gloire de Dieu et nous déshumanisent. Jésus nous met en garde contre elles quand il dit : « Beaucoup viendront en mon nom et diront : ‘C’est moi et le moment fixé est arrivé’ », ce qui en grec donne ego eimi, “Je Suis”, la manière dont Dieu lui-même se présente.
Face à l’anxiété, Jésus nous rappelle ne pas placer notre confiance dans notre jugement ou les signes que nous croyons percevoir. Un exemple malheureux de cette attitude se trouve dans la lettre que Paul adresse à la communauté de Thessalonique qu’il a lui-même fondée. Dans cette communauté, certains ont délaissé leur foi en l’évangile et leurs responsabilités envers la communauté, pensant que la fin des temps était déjà là. Ils ont arrêté d’œuvrer et de s’engager parce qu’ils ont fait de leur situation présente une fin en soi. Ils ont jugé unilatéralement qu’ils n’avaient plus de responsabilité envers les autres et envers la communauté, car en un sens, tout était accompli et satisfait pour eux. L’ironie ici est que ce passage, qui est souvent utilisé par les adversaires des systèmes de solidarité – comme la Sécurité sociale – est en fait une correction de ceux qui croient ne plus avoir besoin d’œuvrer pour la communauté et les autres sauf s’il s’agit de décider pour eux. La remontrance de Paul dénonce une situation en tout point semblable à la ploutocratie dans laquelle nous vivons. Une minorité de personnes et d’entreprises, qui évitent l’impôt par des montages fiscaux ou des dissimulations et qui refusent de ce fait de participer à la solidarité nationale, ne sont pas moins celles qui prennent des décisions politiques et sociales pour l’ensemble de la société. Le mot en grec que Paul utilise pour qualifier l’attitude de ceux qu’on peut bien appeler des profiteurs est periergázomai, c’est-à-dire ceux qui “travaillent tout autour” : ils travaillent, manipulent les autres et la société, sont obnubilés par ce que les autres font ou ne font pas, mais ne travaillent pas eux-mêmes pour le Royaume. Face à ces dérives, Paul invite l’Église de Thessalonique et nous tous à participer à l’œuvre et au travail du Christ, qui est bien différent des structures du travail et des inégalités de notre société. Si l’on se joint à ce travail, à cette œuvre, nous dit Paul, à la suite du Christ, à la suite de Paul lui-même, nous gagnerons une nourriture et une vie qui ne périssent pas ; nous trouverons une ferme fondation pour nos vies.
Nous avons tous tendance à attribuer trop de pouvoir à nos difficultés et à nos situations présentes. Elles sont effectives mais elles sont moins réelles que le pouvoir du Christ auquel nous participons. Lorsque je suis enveloppé d’anxiété, je perds de vue Dieu et le travail merveilleux qu’il accomplit dans ma vie, dans notre monde et dans notre Église. On oublie rapidement que Jésus a grand besoin que nous participions à l’œuvre qu’il a commencée. Le travail auquel Dieu nous appelle fait partie de notre vocation humaine : non seulement créés à l’image de Dieu, mais aussi rachetés en notre humanité par lui. À travers notre persévérance, nous gagnons non seulement notre salut mais aussi la paix dès ce monde. Le mot que Paul utilise d’ailleurs quand il parle de “travail” est celui traduit dans la Genèse par “prendre soin” du jardin, et évoque aussi le culte dans le temple. Alors que le temple n’existe plus mais trouve en Jésus, en l’Église dispersée, sa nouvelle forme, nous sommes tous invités à entrer en communion avec le Christ où que nous soyons pour que le royaume de Dieu advienne et que tombent les fausses idoles économiques, politiques ou religieuses qui nous divisent et nous dominent. L’œuvre à laquelle le Christ nous appelle n’est pas un travail d’exploités mais une manière, à même notre quotidien, d’être formé en celui qui a réalisé notre salut par sa persévérance.
C’est à Jésus lui-même que nous devons tenir. La résistance à l’inquiétude et son renversement en espérance passent par notre participation au Christ. Jésus énumère des signes de la fin des temps, mais insiste : « Avant tout cela », les disciples doivent témoigner de lui et participer à l’avènement du Royaume prophétisé par Isaïe. Comment nous ancrer dans ce modèle de Jésus et non dans nos compréhensions, réussites ou inquiétudes personnelles ou communautaires ? En nous reliant à lui par l’Église et par le service, ce que Paul appelle « ne pas se lasser de faire le bien ». Cela commence par notre attention à la communion que nous partageons en Christ — avec Dieu, avec chaque être humain et avec toute la création. Cela s’exprime dans notre service aux autres, ici dans notre Église par le bénévolat, et dans la société en soutenant toute action politique, comme la Sécurité sociale, qui vise à restaurer et préserver la dignité de chacun.