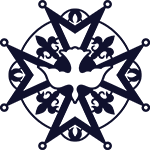Pentecost XX
October 26, 2025
Joel 2:23-32 II Timothy 4:6-8, 16-18 Luke 18:9-14
The United States is a fascinating country. Few places in the world have such a diversity of movements that all claim to follow the same Jesus Christ. I wouldn’t be surprised if God himself had given up counting how many church movements there are in this holy mess! These churches vary greatly in their history, traditions, ways of interpreting Scripture, organizing themselves, and worshipping God. What also distinguishes them is their economic, cultural, or ethnic composition, linked to the history of slavery or different waves of migration. What has always amazed foreign observers, such as Alexis de Tocqueville, is that these different religious movements tolerate each other in an exceptionally peaceful manner. Some Christians, such as the Episcopal Church and the Anglican Communion in the years 1886-1888, saw this as a harbinger of a possible peaceful gathering of all this diversity. On pages 726-727 of the Book of Common Prayer, you can read the Chicago-Lambeth Quadrilateral, which aimed to establish a common basis for the rapprochement of all churches. It didn’t fully work out. Unfortunately, as we know all too well, the fact that two people praise the same God, even in the same temple or country and at the same time, is not enough for them to truly do so together and with one heart. The fact that so many churches and Christians all pray to the same God in one and the same country is not enough to make them all recognize each other as brothers and sisters.
In his Gospel, Luke recounts several of Jesus’ teachings on prayer. He invites us to rethink our preconceptions about what prayer is, what it does to us and to the world around us. Through the story of the mustard seed, Jesus showed us that prayer is not measured by our strength or the intensity of our religious feelings: it is a simple relationship of dependence on God that enables us to do impossible things. To those who despaired of the effectiveness of their prayers, he told the story of the widow and the unjust judge, showing that perseverance in prayer and protest against injustice brings about the Kingdom, even if the whole system will not change overnight. Prayer, Jesus shows us, does not depend on our strength, but on our relationship with God. It is maintained with all our hearts and through all our actions.
Today’s Gospel continues to explore what prayer truly is. Jesus does not address this story to discouraged people, but rather to “those who believed they were doing God’s will and despised others.” This is an attitude that is unfortunately all too common today in the political and religious spheres. Jesus tells a story that contrasts the attitudes of two men who come at the same time, in the same place, to offer their prayers to God. One, the Pharisee, is a Jew in impeccable standing. The Pharisees were a very scrupulous Jewish sect who followed the Torah to the letter and even did more than it required. Everything he lists as his “accomplishments” goes beyond what the Law requires. Your imagination will have no trouble finding contemporary equivalents for him. The other, a tax collector, is anything but a well-to-do Jew. He is a Jew, to be sure, but he collects taxes for Rome, taking a percentage for himself in the process. For nationalist Jews, such as the Zealots, he is the very embodiment of idolatry: he collects money for the Emperor, whom some consider a god. He is a collaborator and an infidel.
Jesus tells this story to disabuse us of our inauthentic and idolatrous way of relating to God. The contrast between the Pharisee’s prayer and that of the tax collector is eloquent. When he prays, the Pharisee lists his merits, comparing himself favorably to others: he talks about who he is and what he does that is good, unlike others: “I thank you,” “I am not…,” “I fast,” “I give to you.” The tax collector, on the other hand, addresses God simply and directly, making a request in the imperative: “Have mercy on me.” He enters into dialogue with God, a dialogue in which he defines himself as indebted to God by describing himself as a “sinner.” The Pharisee puts on an act, he prays himself up before God and society, while the tax collector simply presents himself as he is. One is in his head and in politics, the other is in his heart and in faith. One enters into an ideological, theological, political, religious, and social discussion with God, society, and himself; the other truly addresses God, enters into a relationship with him, and expects his life from him. These two characters and their different attitudes show that talking about God or talking to God is not all there is. It is even very little and will not make us “righteous in the eyes of God” if we do not embrace the fact that genuinely relating to our ourselves and others (“love the other as yourself”) is as important as loving God. Genuinely striving to love your neighbor or yourself is always more important than loving an ideology, a rule, or a prejudice, whether political, social or “Christian”. God does not want us to merely believe in him, he wants us to live him. The way we live him is by loving, and where we are is where it starts.
This parable is not only a warning against religious or spiritual arrogance that leads us into impersonal relationships with God and our neighbors. It is also an encouragement to those who do not necessarily feel worthy to stand before God or do not know how to pray. As the effective prayer of the tax collector shows, praying is not about showing off before God. It is simply living in intimacy with God, so that God may comfort us, heal us, and allow us to participate in his comfort and healing of the world. What we have been does not matter: for it is God, the one who was, who is, and ever will be, who takes us into himself. This is the whole mystery of his incarnation in Jesus Christ, God and human like us. When we pray to God in Jesus Christ, we can offer him all that we are, our whole incarnation, all our weight, all our problems, and all our divisions.
We are painfully divided and pulled apart today in our lives, in our families, in our countries, in our world and even as the Body of Christ, but when we entrust ourselves to him, when we enter into him as those two men entered the temple, as when we participate in the Eucharist or enter into prayer, he who was, is, and ever shall be, leads us all into his wholeness. It is his heart, the heart of Jesus Christ, that reconciles us, a heart that is always more generous than ours, broader than our small ideas about ourselves, about others, about God. JFAB+
Pentecôte XX 26 octobre 2025 Joël 2:23-32 II Timothée 4:6-8, 16-18 Luc 18:9-14
Les États-Unis sont un pays fascinant. Peu d’endroits au monde ont une telle diversité de mouvements qui se réclament tous d’un seul et même Jésus-Christ. Il ne m’étonnerait pas que le bon Dieu lui-même ait arrêté de compter combien il y a de mouvements d’églises dans ce sacré micmac ! Ces églises varient grandement par leur histoire, leurs traditions, leurs manières d’interpréter les Écritures, de s’organiser et de louer Dieu. Ce qui les distingue, c’est aussi leur composition économique, culturelle ou ethnique, liée à l’histoire de l’esclavage ou aux différentes vagues de migration. Ce qui a toujours étonné les observateurs étrangers, comme par exemple Alexis de Tocqueville, c’est aussi que ces différents mouvements religieux se tolèrent d’une manière exceptionnellement pacifique. Certains chrétiens, comme l’Église épiscopale et la Communion anglicane dans les années 1886-1888, y ont vu le signe avant-coureur d’un possible rassemblement pacifique de toute cette diversité. Aux pages 726-727 du Livre de la prière commune, vous pourrez lire le « Quadrilatère de Chicago-Lambeth », qui visait à établir une base commune pour le rapprochement de toutes les Églises. Ça n’a pas vraiment marché. Malheureusement, comme on le sait trop bien, le fait que deux personnes louent un seul et même Dieu, même dans un seul et même temple ou pays et à un seul et même moment, ne suffit pas pour qu’elles le fassent vraiment ensemble et d’un seul et même cœur. Que tant d’églises prient toutes le même Dieu dans un même et seul pays ne suffit pas à faire qu’elles se reconnaissent toutes comme sœurs.
Dans son Évangile, Luc nous rapporte plusieurs enseignements de Jésus sur la prière. Il nous invite à revoir nos préjugés sur ce qu’est prier, ce que ça fait de nous et du monde qui nous entoure. Par l’histoire du grain de moutarde, Jésus nous a montré que la prière ne se mesure ni à notre force ni à l’intensité de notre sentiment religieux : elle est une relation simple de dépendance à Dieu qui nous rend capables de choses impossibles. À ceux qui désespéraient de l’efficacité de leurs prières, il a raconté l’histoire de la veuve et du juge injuste, montrant que persévérer dans la prière et la protestation face à l’injustice fait advenir le Royaume, même si tout le système ne changera pas du jour au lendemain. La prière, nous montre Jésus, ne dépend pas de nos forces, mais de notre relation à Dieu. Elle s’entretient de tout cœur et par toutes nos actions.
L’évangile d’aujourd’hui continue à explorer ce qu’est véritablement prier. Jésus ne s’adresse pas avec cette histoire à des gens découragés, mais au contraire à « ceux qui croyaient faire la volonté de Dieu et méprisaient les autres ». Une attitude qu’on retrouve malheureusement trop souvent aujourd’hui dans la sphère politique ou religieuse. Jésus raconte une histoire qui contraste l’attitude de deux hommes qui viennent adresser au même moment, dans un même lieu, leur prière à Dieu. L’un, le pharisien, est un Juif bien sous tout rapport. Les pharisiens étaient une secte juive très scrupuleuse qui suivait la Torah à la lettre et en faisait même plus que ce qu’elle demandait. Tout ce qu’il liste comme ses « accomplissements » va plus loin que ce que la Loi demande. Votre imagination n’aura pas de mal à lui trouver des équivalents contemporains. L’autre, un collecteur d’impôts, est tout sauf un Juif bien comme il faut. C’est un Juif certes, mais qui collecte les impôts pour Rome et l’Empereur, en prenant un pourcentage au passage. Pour les Juifs nationalistes, comme le groupe des zélotes, il est l’incarnation même de l’idolâtre : il collecte de l’argent pour l’Empereur que certains considèrent comme un dieu. C’est un collaborateur et un infidèle.
Si Jésus raconte cette histoire, c’est bien pour nous désabuser d’une manière inauthentique et idolâtre que nous avons de nous rapporter à Dieu. Le contraste entre la prière du pharisien et celle du collecteur d’impôts est éloquent. Quand il prie, le pharisien fait la liste de ses mérites en se comparant avantageusement aux autres : il parle de ce qu’il est et de ce qu’il fait de bien contrairement aux autres : « je te remercie », « je ne suis pas… », « je jeûne », « je te donne ». Le collecteur d’impôts, au contraire, s’adresse simplement et directement à Dieu, il lui adresse une demande à l’impératif : « prends pitié de moi ». Il entre en dialogue avec Dieu, un dialogue dans lequel il se définit comme redevable à Dieu en se décrivant « pécheur ». Le pharisien se rêve, il se raconte devant Dieu et devant la société, tandis que le collecteur d’impôts se présente simplement tel qu’il est. L’un est dans sa tête et dans la politique, l’autre est dans son cœur et dans la foi. L’un entre dans une discussion idéologique, théologique, politique, religieuse et sociale avec Dieu, la société et lui-même ; l’autre s’adresse vraiment à Dieu, entre en relation avec lui et attend de lui sa vie. Ces deux personnages et leurs attitudes différentes montrent que parler de Dieu ou parler à Dieu n’est pas tout. C’est même très peu et ne nous fera pas « reconnaître justes aux yeux de Dieu » si nous n’embrassons pas le fait qu’entrer en relation authentique avec notre prochain et nous-même (« aime ton prochain comme toi-même » !) est aussi important qu’aimer Dieu. Cultiver un amour authentique du prochain et de nous-même est toujours plus important qu’aimer une idéologie, une consigne ou un préjugé, qu’ils soient politiques, sociaux ou « chrétien ». Dieu ne veut pas que nous croyions seulement en lui, il veut que nous le vivions. Et la manière dont on le vit c’est en aimant, et ça se passe ici et maintenant.
Cette parabole n’est pas seulement un avertissement contre l’arrogance religieuse ou spirituelle qui nous fait entrer dans des relations impersonnelles avec Dieu et nos prochains. C’est aussi un encouragement pour celles et ceux qui ne se sentent pas forcément dignes de se présenter devant Dieu ou ne savent pas prier. Comme le montre la prière du collecteur d’impôts qui a de l’effet, prier ce n’est pas se la raconter devant Dieu. C’est simplement vivre dans l’intimité de Dieu, pour que Dieu nous console, nous guérisse et nous donne de participer à sa consolation et à sa guérison du monde. Ce que nous avons été n’a pas d’importance : car c’est Dieu, celui qui a été, qui est et qui sera, qui nous prend en lui. C’est tout le mystère de son incarnation en Jésus-Christ, Dieu et homme comme nous. Quand nous le prions en Jésus-Christ, nous pouvons lui offrir tout ce que nous sommes, toute notre incarnation, tout notre poids, tous nos problèmes et toutes nos divisions.
Nous sommes aujourd’hui douloureusement divisés et déchirés : dans nos vies, dans nos familles, dans nos pays, dans notre monde, et même au sein du Corps du Christ. Mais lorsque nous nous confions à lui, lorsque nous entrons en lui comme ces deux hommes entrent dans le temple, lorsque nous participons à l’Eucharistie ou que nous entrons en prière, celui qui était, qui est et qui sera à jamais nous conduit tous en sa plénitude. C’est son cœur, le cœur de Jésus-Christ, qui nous réconcilie, un cœur toujours plus généreux que le nôtre, plus vaste que nos petites idées sur nous-mêmes, sur les autres et sur Dieu.
JFAB+