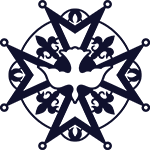English
Pentecost XVI September 28, 2025
Jeremiah 32:1-3, 6-15 1 Timothy 6:6-19 Luke 16:19-31
When in church, we often read Jesus’ stories in a very devotional way, which sometimes keeps us from seeing that they are often caricatural, humorous, or even biting. Much of his social critique and his moral insightsare expressed in this manner. We tend to listen to or to read Jesus’ words as if they were the oracles of a deity—and, of course, Jesus is God—but we forget that he is God incarnate, revealing himself through the artistry of a first-century Palestinian rabbi. Jesus knows how to captivate his audience by playing on contrasts and exaggerations typical of the literary genre of fables. Today’s Gospel story is no exception: the contrasts are set up from the beginning and intensify as the story unfolds. The rich man gorges himself all day, decked out in the latest fashions, while Lazarus, the poor man, sleeps on his mat, covered only with sores and the drool of dogs.
Without any transition, the two pass from life to death and find themselves on the other side. And the irony continues there: the rich man, burning in torment, lifts his eyes and sees the one he never looked at on earth at peace with Abraham. They meet before Abraham as in those jokes where X and Y die and stand before Saint Peter. And the humor goes on: the rich man, who all his life dominated and gave orders, does not change even on the other side! He asks Abraham to order Lazarus about. He still believes he can order anything, when he should be laying low… First, he asks Lazarus to give him a drink, then, perhaps more to justify his situation than out of true compassion, he asks Lazarus to warn his own brothers.
Through situational and repetitive humor, this story reveals theobstinacy of the rich man. Even in hell, he retains the mentality of privilege. Through a brief and simple story, Jesus describes a social phenomenon that Canadian and American researchers have recently highlighted in a pioneering study on the link between socioeconomic status and empathy. By comparing the ability of people from different backgrounds to recognize emotions on others’ faces, they found that individuals from lower-status backgrounds were better at identifying emotions than those from privileged backgrounds. Social class therefore does not only determine access to material resources but also shapes how individuals relate to one another. Those with less tend to be more attentive to others, likely because they depend more on networks of social support and cooperation. This discoverychallenges the idea that privilege enhances emotional and social skills.
Our rich man is imprisoned by his wealth, status, privileges, and mindset. He is trapped in his character: he is no longer truly a person. Jesus does not even give him a name: but Lazarus has one. Even the means he proposes to improve his situation reveal his entrapment and class biases. His situation seems hopeless. As Abraham says, there is a real chasm between the peace of heaven and the hell where this rich man now finds himself.
But at this point, we have to notice two things. First, the rich man always has the possibility of turning back to God and his neighbor—even amid his torment. But he does not! He never tries to listen to Lazarus or Abraham, never turns toward God, never asks for forgiveness. In his torment, he only thinks of improving his own situation and that of his clan. If he were to look at anything beyond himself, there would be hope—but he chooses not to.
Second, we must remember that it is Jesus himself who tells this story. He, who, on his way to Jerusalem to face his Passion, will accomplish what Abraham thinks impossible: raising people like this rich man – like us, who always tend to live for ourselves – back to life. Christ throws a bridge over the chasm: the bridge is the way of his cross. To model our life on his is to walk this bridge. The infinitely rich Son of the Creator became poor for us, as Saint Paul says. Because it is Jesus who tells this story, we see that the problem is not owning money, possessions, or advantages, but what we do with them: do we relate them to God and others, or use them to serve ourselves and our social circle? God reveals in Jesus a love that disarms us. It prevents us from justifying ourselves, because he gives himself completely to us. A love that guides us through those loving words, and that can even take the form of a parable with biting humor.
Reflecting on the sociological study I mentioned considering the story of Lazarus and the rich man, I wondered: what would the conclusions have been if the researchers had studied people who genuinely try to model their lives on Christ? If they had taken people who, even if privileged, strive to live the Christian virtues of humility, attentiveness, and generosity? It may seem small to struggle within ourselves and in the world around us for these virtues of solidarity and generosity. It may even seem almost insignificant in view of the vast social inequalities in the United States and the world. But it is a lot when we hear that public figures whose voices prevail in our societies loudly profess selfishness, “us first,” and to denigrate anything foreign or poor. In the toxic ideological atmosphere surrounding us, marked by greed and the defense of identity-based interests, those who model their lives on Christ are already choosing a different path: to welcome and give of themselves. To acknowledge our failings. Every day we can choose not to turn a blind eye to injustice; not to call evil good and good evil, not to spread unverified information; not to treat people differently based on their status or background. We can choose not to despair. Aristotle said that virtues are not inborn. That gives us hope! They are cultivated through habit, the repetition of good actions. For us Christians, we become more fully alive by aligning all our relationships with the love of God and neighbor. And we do this first by communing with Christ, receiving through his word and the offering of himself at this altar the power of God in the weakness of our humanity. It is in Jesus, in receiving him in the Eucharist and in our brothers and sisters, that the great chasm is bridged. The bridge that allows us to reach ourselves and others is already here.
Tomorrow is the feast of Saint Michael the Archangel and the Holy Angels. Let us rely on realities greater than ourselves to help us on this path. From above those angels see our journey with greater perspective. They know our struggles and desires while they contemplate God. Let us entrust ourselves to God and listen to those he sends to guide, convert, protect, and console us. Salvation always comes from God, provided we allow ourselves to be carried to God by his angels. Just like Lazarus. JFB
Français
Pentecôte XVI 28 septembre 2025 Jérémie 32:1-3, 6-15 1 Timothée 6:6-19 Luc 16:19-31
Dans l’Église, on lit les histoires que raconte Jésus de manière assez dévote, ce qui nous empêche parfois de voir qu’elles sont en fait souvent caricaturales, drôles ou grinçantes. Beaucoup de sa critique sociale, mais aussi de sa réflexion morale, passent par cela. On tend à écouter ou lire les paroles de Jésus comme les oracles d’une divinité, et bien sûr Jésus est Dieu, mais on oublie qu’il est Dieu incarné et qu’il se révèle à travers l’art d’un rabbi de Palestine du premier siècle. Jésus sait captiver son auditoire en jouant sur des contrastes et des exagérations typiques du genre littéraire de la fable et l’histoire de l’évangile d’aujourd’hui n’est pas en reste avec ses contrastes mis en scène dès le début et qui s’accentuent ensuite. L’homme riche se goinfre toute la journée sapé de la dernière mode, tandis que Lazare, le pauvre, dort sur son paillasson, couvert seulement de plaies et de la bave des chiens. Sans transition, les deux passent de vie à trépas et se retrouvent de l’autre côté. Et là l’ironie continue : l’homme riche, brûlant dans la tourmente, lève les yeux et voit celui qu’il ne regardait jamais sur terre en paix auprès d’Abraham. Ils se retrouvent devant Abraham comme dans ces blagues où X et Y meurent et vont devant Saint-Pierre. Et l’humour continue : l’homme riche, qui toute sa vie a dominé et commandé, n’arrête pas même de l’autre côté ! Il demande à Abraham de donner des ordres à Lazare. Il se croit encore tout permis alors qu’il devrait faire profil bas… Il demande d’abord que Lazare lui donne à boire, puis, peut-être plus pour justifier sa situation que par véritable compassion, que Lazare aille prévenir ses frères.Ce que cette histoire fait transparaître par un comique de situation et de répétition, c’est bien l’entêtement de l’homme riche. Même en enfer il garde sa mentalité de privilégié. Par une histoire brève et simple, Jésus décrit un phénomène social que des chercheurs canadiens et américains ont mis en lumière récemment dans une étude pionnière sur le lien entre statut socio-économique et empathie. En comparant la capacité de personnes de milieux différents à reconnaître les émotions sur les visages d’autrui, ils ont constaté que les individus au statut le plus bas identifiaient mieux les émotions que ceux issus de milieux privilégiés. La classe sociale ne détermine donc pas seulement l’accès aux ressources matérielles, mais aussi la manière dont les individus se relient les uns aux autres. Ceux qui disposent de moins tendent à être plus attentifs aux autres, sans doute parce qu’ils dépendent davantage des réseaux de sociabilité et de la coopération. Cette découverte a remis en cause l’idée selon laquelle le privilège favorise les compétences émotionnelles et sociales.
Notre homme riche est donc prisonnier de ses richesses, de son statut, de ses privilèges, de sa mentalité. Il est enfermé dans son personnage : il n’est plus une personne. Jésus ne lui donne même pas de nom d’ailleurs, tandis que Lazare en a un. Même les moyens qu’il propose pour sortir de sa situation témoignent de son enfermement et de ses préjugés de classe. Sa situation semble sans issue. Comme le dit Abraham, il y a un véritable abîme entre la paix du ciel et l’enfer où est ce riche. Mais à ce moment-là, ilfaut faire attention à deux choses. D’abord le fait que le riche a toujours la possibilité de revenir vers Dieu et son prochain. Même au milieu de sa tourmente. Mais il ne le fait pas ! Il ne cherche jamais à écouter Lazare ou Abraham, ni à se tourner vers Dieu, ni à demander pardon. Dans sa tourmente il ne pense qu’à améliorer sa propre situation et celle de son clan. Pour peu qu’il regarde autre chose que son nombril, il y aurait de l’espoirmais il choisit de ne pas le faire.
La deuxième chose à garder à l’esprit, c’est que c’est Jésus lui-mêmequi raconte cette histoire. Lui qui, alors qu’il se dirige vers Jérusalem pour vivre sa passion, va réaliser ce qu’Abraham ne croit pas possible : revenir des morts pour faire revenir à la vie des gens comme ce riche, comme nous, qui tendons toujours à vivre d’abord pour nous-mêmes. Le Christ nous lance un pont au-dessus de l’abîme : c’est la voie de sa croix. Modeler notre vie sur la sienne, c’est prendre ce pont. Lui qui, alors qu’il est infiniment riche comme Fils du Créateur, est devenu pauvre pour nous comme le dit Saint Paul. Que ce soit Jésus qui raconte cette histoire nous montre que le problème n’est pas d’avoir de l’argent, des biens ou des avantages, mais ce que nous en faisons : les rapportons-nous à Dieu et aux autres, ou les utilisons-nous pour nous faire servir et servir notre caste ? Dieu révèle en Jésus un amour qui nous désarme, qui nous empêche de nous justifier, car il se donne complètement à nous. Un amour qui nous guide par ses paroles d’amour, qui peuvent même prendre la forme d’une parabole à l’humour grinçant.
En pensant à l’étude sociologique que j’ai mentionnée à la lumière de l’histoire de Lazare et de l’homme riche, je me suis demandé : qu’en seraient les conclusions si les chercheurs avaient étudié des gens qui cherchent vraiment à modeler leur vie sur le Christ ? S’il avaient pris desgens qui, même privilégiés, cherchent à vivre les vertus chrétiennes d’humilité, d’écoute, de générosité ? Lutter en nous-mêmes et autour de nous, dans notre vie intérieure, sociale et politique, pour ces vertus de solidarité et de générosité, cela ne paraît pas grand-chose. Ça paraît même très peu quand on sait l’étendue des inégalités sociales aux Etats-Unis et dans le monde. Mais c’est beaucoup quand on entend que personnages publics dont la voix porte dans nos sociétés font la profession bruyante de l’égocentrisme, du “nous d’abord” et de dénigrement de tout ce qui leur est étranger ou pauvre. Dans l’ambiance idéologique délétère qui nous entoure, marquée par la convoitise et la défense d’intérêts identitaires, ceux qui modèlent leur vie sur le Christ choisissent déjà une autre voie : accueillir et se donner. Reconnaître nos manquements. Nous pouvons choisir au quotidien de ne pas fermer les yeux sur une injustice, de ne pas appeler le bien mal et le mal bien, de ne pas relayer d’informations non confirmées, de ne pas traiter les gens différemment selon leur statut ou leurs origines. Nous pouvons choisir de ne pas désespérer. Aristote disait que les vertus ne sont pas innées. Voilà de quoi nous donner espoir ! Elles se cultivent par l’habitude, la répétition de bonnes actions. Pour nous chrétiens, nous devenons davantage vivants en réglant toutes nos relations sur l’amour de Dieu et du prochain. Et nous le faisons d’abord en communiant au Christ, en accueillant par sa parole et l’offrande de lui-même à cet autel la force de Dieu dans la faiblesse de notre humanité. C’est en Jésus, en le recevant dans l’Eucharistie et dans nos frères et sœurs, que se comble le grand abîme. Le pont qui nous permet d’aller vers nous-mêmes et vers les autres se trouve ici.
Demain c’est la fête de saint Michel Archange et des saints anges. Comptons sur des réalités plus grandes que nous pour nous aider dans ce chemin. D’autres, d’en haut, voient notre route avec plus de recul. Ils connaissent nos difficultés et nos désirs tout en contemplant Dieu. Confions-nous à Dieu et soyons à l’écoute de ceux qu’il envoie pour nous guider, nous convertir, nous protéger et nous consoler. Le salut vient toujours de Dieu pour peu qu’on se laisse porter, comme Lazare, par ses anges vers lui.
JFB