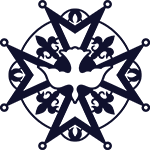All Saints Sunday
November 2, 2025
Daniel 7:1-3, 15-18 Ephesians 1:11-23 Luke 6:20-31
About twenty years ago, the first filmed documentary on the life and work of Dorothy Day appeared. It is famously titled, ‘Don’t call me a saint’. The title is part of a longer quotation attributed to her: “Don’t call me a saint. When they call you a saint, it means basically that you are not to be taken seriously”. She was speaking in a very specific context: that of a woman working with the poor – specifically women – here in New York City. The same challenge was faced by Dom Hélder Câmara during the military dictatorship in Brazil. “When I give food to the poor, they call me a saint. When I ask why they are poor, they call me a Communist.” I can see the point that both of them are making. We are tempted to call living people ‘saints’ when we see them doing something extraordinarily good that we would find very difficult to do ourselves. It’s a way of saying that they are exceptional; enormously brave; inimitable; something so out of reach for most of us that we can put people like them into a safe category of their own. Yet both Dorothy Day and Hélder Câmara believed that it was the responsibility of every Christian to live a holy life: to desire to be saint-like.
It is quite the quandary when considered in this way. The Bible describes all Christian people as saints, whether they were famously courageous, visionary, or particularly holy or not. We don’t even know the name of the first person granted entry to paradise by Jesus’ death on the cross. You can ask me about his story later. But given the way the church has singled out certain named people for special memory, our questions remain. Can you even know if you are a saint? What about all those unnamed people who have given themselves to humanity in sacrificial ways that have led to their own suffering and even death? Is a the desire to live a saintly life a way of challenging the arrogance and pride we see so often exhibited by people in our public life? Or is even the desire to be a saint self-cancelling? In other words, if you want it, you’ve already disqualified yourself? Could I be a saint?
On first sight, Dorothy Day doesn’t seem to a promising candidate for official sainthood. Her biography is quite the story. She lived a bohemian life in Greenwich village. She associated with Communists, had an illegal abortion, attempted suicide, lived in a common-law marriage and had a child out of wedlock. But that story shows us several important things about sainthood. Firstly, it is rooted in our world; often in the hardest, most exploited, isolated and evil places in our world. Secondly, her story reminds us that sainthood should not be a cult of Christian celebrity. The saintliest among us could never be saints without the Christian community supporting us. Most of us know this from personal experience.
Thirdly, her story reminds us that we all have a story to tell about ourselves, or a story which others can tell of us. Saint-Esprit has a little cemetery in Queens. Last year Joris and Madi took us on a tour of Greenwood cemetery, telling us the stories of many people associated with St. Esprit who are buried there; including three of our rectors. Those life stories give us a way of understanding ourselves, and of understanding the ways that Christ is still at work in the world. I was often moved when I presided at funerals of people I didn’t know in my first parish in England, because of the stories people told about their friends or their relatives who had died. Their selective memories of the departed gave them hope and courage. Such memories comforted them in the knowledge that there is something in every life which is not only worth telling, but which is also stronger than death.
We have a similar selective memory about the saints. They are people who have been chosen by the church as examples not for their perfection, but frequently for their mixture of frailty and faith. They include among their number cowards who turn brave, lovers who offer their passion to God, minds that long for God and have no peace until they find him, ordinary wives or sons or fathers obliged to do extraordinary things. They are exemplars of the sorts of stories which can be told about us. Their weaknesses are not subsumed in their sanctification: their weaknesses are often the means by which their greatness is communicated to those who try to model their lives on theirs. It is curious that this time of year is chiefly known for Halloween: the festival in which, instead of celebrating the lives of those whom we have loved and who have died, we are supposed to be haunted by the dead: those who were once like us and who now supposedly inhabit a world which manifests itself to us in scary, half-glimpsed terrors.
Their terrors are over. They lived worse terrors during their lives than the costumes and disguises in which we clothe the inevitability of death. Our little church has been in this city for almost four hundred years. The crests and memorials of saints and sinners line our walls and are written on our icons. We are custodians of their memory. We need all the help we can get from their stories, and from our own stories too. Including the story of Saint Paul Jones, Mark’s great uncle, whose photograph album has been bequeathed to us and is on our memory table. The chalice we will use today was last used thirty years ago by a priest who was a survivor of Dachau concentration camp. Let us thank God for those who have come before us. Churches are communities devoted to remembrance. Not one of our stories is lost. One day we will see our lives through the all-seeing eyes of Christ, who told us; ‘Do this in memory of me’. Our earthly lives are merely the prelude to a great story which goes on forever, and in which every chapter is better than the one before.
Dimanche de la Toussaint 2 novembre 2025 Daniel 7, 1-3, 15-18 Éphésiens 1, 11-23 Luc 6, 20-31
Il y a environ vingt ans, est sorti le premier documentaire sur la vie et l’œuvre de Dorothy Day. Il porte le célèbre titre « Ne m’appelez pas une sainte ». Ce titre est tiré d’une citation plus longue qui lui est attribuée : « Ne m’appelez pas une sainte. Quand on vous appelle une sainte, ça signifie en gros qu’on ne vous prend pas au sérieux ». Elle s’exprimait dans un contexte très particulier : celui d’une femme travaillant avec les pauvres – en particulier les femmes – ici, à New York. Dom Hélder Câmara a été confronté au même défi pendant la dictature militaire au Brésil. « Quand je donne à manger aux pauvres, on m’appelle un saint. Quand je demande pourquoi ils sont pauvres, on me traite de communiste. » Je comprends le point de vue de ces deux personnes. On est tenté de qualifier les personnes vivantes de « saints » lorsqu’on les voit faire quelque chose d’extraordinairement charitable qu’on aurait beaucoup de mal à faire soi-même. C’est une façon de dire qu’ils sont exceptionnels, extrêmement courageux, inimitables, tellement hors de portée pour la plupart d’entre nous que on peut les classer dans une catégorie bien à part, hors d’atteinte. Pourtant, Dorothy Day et Hélder Câmara croyaient tous deux qu’il était de la responsabilité de chaque chrétien de mener une vie sainte, de désirer être comme un saint.
C’est un peu un dilemme lorsqu’on y réfléchit. La Bible décrit tous les chrétiens comme des saints, qu’ils aient été célèbres pour leur courage, leur vision ou leur sainteté particulière ou non. Nous ne connaissons même pas le nom de la première personne à qui Jésus a accordé l’entrée au paradis par sa mort sur la croix. Je pourrais vous raconter son histoire si vous voulez. Mais étant donné la manière dont l’Église choisit certaines personnes pour leur rendre un hommage particulier, les questions persistent. Est-ce qu’on peut savoir si on est un saint ou une sainte ? Qu’en est-il de tous ces anonymes qui se sont sacrifiées pour l’humanité, au prix de souffrances, voire jusqu’à la mort ? Est-ce que vouloir mener une vie sainte est un moyen de défier l’arrogance et l’orgueil dont font si souvent preuve les personnalités publiques ? Ou est-ce que désirer être saint c’est déjà ne plus l’être ? En d’autres termes, si vous le désirez, est-ce que vous vous disqualifiez d’avance ? Est-ce que moi, je pourrais être un saint ?
À première vue, Dorothy Day ne semble pas une candidate prometteuse pour la sainteté officielle. Sa biographie est assez mouvementée. Elle a mené une vie de bohème dans le village de Greenwich. Elle a fréquenté des communistes, a subi un avortement illégal, a tenté de se suicider, a vécu en union libre et a eu un enfant hors mariage. Mais son histoire nous apprend plusieurs choses importantes sur la sainteté. Premièrement, la sainteté est ancrée dans le monde, souvent aux endroits les plus violents, les plus exploités, les plus isolés et les plus malfaisants de notre monde. Deuxièmement, son histoire nous rappelle que la sainteté n’est pas le culte de star chrétiennes. Mêmes les plus saints d’entre nous ne pourraient jamais l’être sans le soutien de la communauté chrétienne. La plupart d’entre nous le savent d’expérience personnelle. Troisièmement, son histoire nous rappelle que nous avons tous une histoire à raconter sur nous-mêmes, ou une histoire que d’autres peuvent raconter à notre sujet. Saint-Esprit possède un petit cimetière dans le Queens. L’année dernière, Joris et Madi nous ont fait visiter le cimetière de Greenwood, nous racontant les histoires de nombreuses personnes associées à Saint-Esprit qui y sont enterrées, dont trois de nos recteurs. Ces histoires de vie nous permettent de mieux nous comprendre nous-mêmes et de comprendre comment le Christ continue d’œuvrer dans le monde. Dans ma première paroisse en Angleterre, j’étais souvent ému en présidant les funérailles de personnes que je ne connaissais pas à cause des histoires que les gens racontaient sur leurs amis ou leurs proches décédés. Leurs souvenirs sélectifs des défunts leur donnaient espoir et courage. Ces souvenirs les réconfortaient, car ils leur rappelaient qu’il y a dans chaque vie quelque chose qui mérite non seulement d’être raconté, mais qui est aussi plus fort que la mort.
Pour ce qui est des saints, on a aussi une mémoire sélective. Les saints sont des personnes qui ont été choisies par l’Église comme des exemples, non pour leur perfection, mais souvent pour leur mélange de fragilité et de foi. Parmi eux, de tous genres, on trouve des lâches qui deviennent courageux, des amants qui offrent leur passion à Dieu, des esprits qui aspirent à Dieu et ne trouvent la paix qu’en le trouvant, des épouses, des maris, des enfants ou des parents ordinaires obligés de faire des choses extraordinaires. Ils ont connu des vies et des histoires similaires aux nôtres. Leurs faiblesses ne sont pas effacées par leur sanctification : elles sont souvent le moyen par lequel leur grandeur est communiquée à ceux qui tentent de modeler leur vie sur la leur. C’est curieux que cette période de l’année soit principalement connue pour Halloween : cette fête au cours de laquelle, au lieu de célébrer la vie de ceux que nous avons aimés et qui sont morts, nous sommes censés être hantés par « les morts » : des morts qui aurait été autrefois comme nous mais qui habiteraient désormais un monde qui reviendraient à nous sous la forme de visions effrayantes et irréelles.
Les morts n’ont plus de quoi être terrifiés. Ils ont connu, de leur vivant, des angoisses bien plus réelles que celles que nous travestissons en costumes et en masques pour dissimuler l’inévitabilité de la mort. Notre petite église est présente dans cette ville depuis près de quatre cents ans. Des blasons et des inscriptions à la mémoire de saints et de pécheurs tapissent nos murs et sont inscrits sur nos icônes. Nous sommes les gardiens de leurs mémoires. Leurs histoires n’en finissent pas de nous venir en aide, et les nôtres aussi. Y compris l’histoire de Saint Paul Jones, le grand-oncle de Mark, dont un album photo nous a été légué et se trouve sur notre table du souvenir. Le calice que nous emploierons aujourd’hui a été utilisé pour la dernière fois il y a trente ans par un prêtre qui a survécu au camp de concentration de Dachau. Remercions Dieu pour celles et ceux qui nous ont précédés. Les églises sont des communautés vouées au souvenir. Aucune de nos histoires n’est perdue. Un jour, nous verrons nos vies à travers les yeux du Christ qui a tout vu et qui nous a dit : « Faites ceci en mémoire de moi ». Nos vies terrestres ne sont que le prélude à une grande histoire qui se poursuit à l’infini, et dont chaque chapitre est meilleur que le précédent.