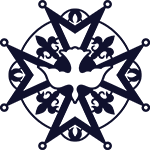Pâques II / Dimanche de la commémoration de la promulgation de l’Édit de Nantes
27 avril, 2025 Actes 5:27-32 Apocalypse 1:4-8 Jean20:19-31
En ce dimanche dit « des Huguenots », nous célébrons l’héritage de ces protestants qui, aux XVIIème et XVIIIème siècles, ont fui la France en raison des persécutions infligées par un Etat absolutiste et autoritaire. Comme les réfugiés et immigrants d’aujourd’hui, ces protestants provençaux, charentais ou champenois ont emporté dans leurs bagages des souvenirs de leur terre natale – parmi lesquels des plantes, des recettes et des savoir-faire. Autant de souvenirs gustatifs, d’odeurs, de traditions du « petit pays » qu’ils avaient dû quitter à jamais, mais dont ils espéraient transmettre la mémoire à leurs enfants et petits-enfants, génération après génération.
Les défis de la transmission d’une génération à l’autre de quelque chose qu’on a chéri n’étaient pas étrangers aux premiers disciples de Jésus. Nous l’avons entendu dans notre lecture de l’Évangile. La rédaction des premiers évangiles correspond au moment où les témoins directs du ministère du Christ commencent à disparaître. Les premières communautés chrétiennes, dispersées et parfois persécutées, ressentent alors le besoin – l’urgence même – de mettre par écrit ce qui avait jusque-là été transmis oralement à propos de Jésus. L’Apocalypse, que nous avons également entendue aujourd’hui, s’adresse à de pareilles églises, vulnérables et éprouvées.
Comme les huguenots exilés et la seconde génération des disciples de Jésus, notre désir de transmettre naît toujours de la conscience de la perte. Nous ne cherchons à faire mémoire que ce que nous craignons de voir disparaître. Nous cherchons à transmettre ce que nous espérons voir nous survivre. Ce sont des circonstances analogues qui ont conduit à la fondation de la Société Huguenote d’Amérique au XIXe siècle, à une époque où de nouvelles vagues d’immigrants « diluaient » – si l’on peut dire – l’héritage des premières vagues de migrants dans ce pays, comme les huguenots. Si nous tenons tant à transmettre nos traditions, nos recettes, nos coutumes ou nos héritages, c’est parce que nous croyons qu’ils sont porteurs d’un sens, d’une provision pour la vie. Ils disent quelque chose de qui nous sommes, de nos valeurs, de nos croyances, de notre dignité. Nos héritages nous ancrent, ils créent un environnement hospitalier, un foyer, un sentiment d’appartenance que nous désirons naturellement offrir à ceux que nous aimons et qui viendront après nous.
Comme le Christ, qui se présente vivant à ses disciples après avoir été mis à mort, nous voyons dans ce que nous transmettons quelque chose de capable de vivre malgré la mort – si ce n’est ressusciter. Quelque chose qui puisse traverser la mort, notre mort. S’il est intéressant de considérer la résurrection sous cet angle, je crois, c’est que la résurrection de Jesus est tout sauf une simple idée, un concept, mais c’est une expérience existentielle, profondément transformatrice, non seulement personnellement pour les protagonistes mais aussi pour leur sens de la communauté. Le retour vivant du Christ agit en ceux qui le vivent. Il s’incarne dans leurs vie et vont le transmettre. Et ce qui est au centre de cette rencontre avec le Ressuscité, ce sont paradoxalement des plaies.
La vie dont témoigne Jésus ressuscité est en cela bien différente de nos traditions et de ce que nous voulons transmettre pour contrer la mort. Contrairement à la manière dont on aime souvent présenter nos traditions ou ce qu’on laisse derrière soi, le corps du Ressuscité n’est pas un corps parfait, tout comme nos communautés, nos sociétés, notre Église ne sont pas intactes et parfaites. Mais c’est justement cela qui nous est donné comme source de joie. Le Vivant nous montre ses plaies, non comme un reproche, mais en disant : « La paix soit avec vous. » Il nous invite à regarder nos propres blessures, celles de notre monde, de nos nations, de nos communautés avec paix. C’est un tout nouveau regard auquel Christ nous invite. Une vie qui ne ressemble pas seulement au désir de faire durer la vie que nous connaissons.
Notre tradition désormais, c’est celle que Jésus nous montre : les blessures sur son corps, infligées par des humains comme nous, et qu’il continue de porter. C’est ainsi qu’il vient à nous, vivant, nous parle et nous donne sa paix. C’est comme ça qu’il nous invite à entrer en communion avec tout le monde. Le corps ressuscité du Christ ne nous pousse pas à fuir la réalité, à nous réfugier dans une certaine idée parfaite de la vie, mais au contraire à l’affronter avec amour et espérance. Elle nous envoie incarner cette liberté nouvelle, celle de la résurrection, là où la mort a encore prise.
Ce n’est qu’après avoir montré ses plaies et apaisé ses disciples que le Christ les envoie, pour qu’à leur tour ils deviennent des porteurs de paix, qu’ils transmettent une nouvelle façon d’être et de voir. Il nous appelle aujourd’hui encore à devenir les témoins de la résurrection c’est-à-dire celles et ceux qui savent lire l’histoire, notre histoire personnelle, institutionnelle, nationale, sans fermer les yeux sur nos blessures mais en étant capables d’en tirer une vie plus grande. Cette expérience des disciples, comme celle de Thomas, a des conséquences sur nos vies personnelles et communautaires à bien des niveaux. Elle nous force à nous rendre compte que ce ne sont jamais des traditions prétendument parfaites ou immaculées qui nous tirent de la peur, de la décadence, du doute ou de l’angoisse. Ce sont au contraire les blessures partagées, les failles reconnues, qui deviennent source de communion, de joie et de paix. Non comme des objets de fascination morbide, mais comme des appels à agrandir notre cercle, approfondir notre communion les uns avec les autres – et avec Dieu. À quoi cela ressemble-t-il, me demanderez-vous ?
À la Grüne Soße allemande, aux French beans anglais, à la chaudrée de Nouvelle-Angleterre ou au vin sud-africain… Tous ces plats transmis par des réfugiés huguenots, déracinés de leur pays natal, sont devenus pour les Allemands, les Anglais, les Américains et les Sud-Africains qui les ont accueillis de véritables plats de communion et d’ancrage national. Pour notre Église, transmettre la vie du Ressuscité, c’est faire de notre longue histoire transpercée par les plaies de l’exil et de l’exploitation un témoignage vivant de la résurrection du Christ, qui ne peut être contenue ni entre quatre murs, ni dans des plaies. Une résurrection qui ne se limite pas à une histoire. C’est imiter Jésus, qui le jour même de sa résurrection dans l’Évangile de Jean ne diffère pas son don de vie nouvelle mais l’insuffle à ses disciples en soufflant sur eux et les envoyant. Il les fait immédiatement participer à sa vie nouvelle et leur donne d’en faire participer d’autres. La résurrection de Jésus, sa paix, peuvent ouvrir nos cœurs, nos esprits, nos communautés — ici et maintenant.
Comme les premiers disciples, nous sommes envoyés dans le monde après que Jésus nous a montré les plaies sur son corps ressuscité. Aujourd’hui nous pouvons servir dans le monde en tant qu’envoyés du Ressuscité, sans détourner le regard de ses blessures, mais sans en être fascinés, effrayés ou nous y enfermer. Cela commence dans nos vies personnelles, cela continue dans nos nations, et cela se vit aujourd’hui dans notre Église. Dans les années à venir, nous aurons de nombreuses occasions de participer à ce partage de la vie que nous recevons lorsque nous regardons le monde à travers les plaies du Christ. Je pense à la préparation du 400ème anniversaire, celui de nos 400 ans de communion – et de manque de communion… Je pense aussi aux nombreuses manières dont nous pouvons tous veiller à ce que le témoignage du Christ dans notre petite part du corps ressuscité du Christ continue pour encore 400 ans : en nous assurant que l’Eglise aujourd’hui ne manque pas de prière, de volontaires ou de ressources. Prions pour que Jésus prononce bienheureux celles et ceux qui viendront à croire grâce à notre fidélité dans la transmission, la redécouverte et la mise en œuvre de ce que nous avons reçu de lui.
Easter II / Huguenot Sunday April 24, 2025 Acts 5:27-32 Revelation 1:4-8 John 20:19-31
On this Sunday known as “Huguenot Sunday,” we celebrate the legacy of those Protestants who, in the 17th and 18th centuries, fled France due to persecution by an absolutist and authoritarian state. Like today’s refugees and immigrants, these Protestants from Provence, Charente, and Champagne brought with them memories of their homeland, including plants, recipes, and skills. These were all taste memories, smells, and traditions from the “little country” they had had to leave behind forever, but which they hoped to pass on to their children and grandchildren, generation after generation.
The challenges of passing on something cherished from one generation to the next were not unfamiliar to the first disciples of Jesus. We heard about this in our Gospel reading. The writing of the first Gospels corresponds to the time when the direct witnesses of Christ’s ministry began to disappear. The first Christian communities, scattered and sometimes persecuted, felt the need—even the urgency—to write down what had until then been passed down orally about Jesus. The Book of Revelation, which we also heard today, is addressed to such vulnerable and tried churches.
Like the exiled Huguenots and the second generation of Jesus’ disciples, our desire to pass on our faith always arises from an awareness of loss. We seek to remember only what we fear will disappear. We seek to pass on what we hope will survive us. Similar circumstances led to the founding of the Huguenot Society of America in the 19th century, at a time when new waves of immigrants were “diluting”—so to speak—the heritage of the first waves of migrants to this country, such as the Huguenots. If we are so keen to pass on our traditions, recipes, customs, or heritage, it is because we believe they carry meaning and provide sustenance for life. They say something about who we are, our values, our beliefs, and our dignity. Our heritage grounds us, creates a welcoming environment, a home; a sense of belonging that we naturally want to offer to those we love and who will come after us.
Like Christ, who appeared alive to his disciples after being put to death, in what we pass on we see something capable of living despite death—even capable of resurrecting. Something that can pass through death; our death. If it is interesting to consider the resurrection from this perspective. I believe it is because the resurrection of Jesus is anything but a simple idea or concept; it is an existential experience, deeply transformative, not only personally for those involved but also for their sense of community. The living return of Christ acts in those who experience it. It is embodied in their lives and they pass it on. And what is at the center of this encounter with the Risen One is, paradoxically, wounds.
The life witnessed by the risen Jesus is very different from our traditions and from what we want to pass on to counter death. Contrary to the way we often like to present our traditions or what we leave behind, the body of the Risen One is not a perfect body, just as our communities, our societies, and our Church are not intact and perfect. But this is precisely what is offered to us as a source of joy. The Living One shows us his wounds, not by way of a reproach, but by saying, “Peace be with you.” He invites us to look at our own wounds, those of our world, our nations, our communities, with peace. Christ invites us to take a whole new look. A life that is not just about the desire to prolong the life we know.
Our tradition now is the one Jesus shows us: the wounds on his body, inflicted by humans like us, which he continues to bear. This is how he comes to us, alive, speaking to us and giving us his peace. This is how he invites us to enter into communion with everyone. The risen body of Christ does not urge us to flee reality, to take refuge in some perfect idea of life, but rather to face it with love and hope. It sends us to embody this new freedom, the freedom of the resurrection, where death still has a hold.
It was only after showing his wounds and reassuring his disciples that Christ sent them out, so that they in turn might become bearers of peace, transmitting a new way of being and seeing. He calls us today to become witnesses of the resurrection, that is, those who know how to read history (our personal, institutional, and national history), without closing our eyes to our wounds but capable of drawing from them a greater life. This experience of the disciples, like that of Thomas, has consequences for our personal and community lives on many levels. It forces us to realize that it is never supposedly perfect or immaculate traditions that draw us out of fear, decadence, doubt, or anxiety. On the contrary, it is shared wounds and acknowledged flaws that become a source of communion, joy, and peace. Not as objects of morbid fascination, but as calls to widen our circle and deepen our communion with one another—and with God. What does that look like, you may ask?
Like German Grüne Soße, English French beans, New England chowder, or South African wine… All these dishes, passed down by Huguenot refugees uprooted from their homeland, have become true dishes of communion and national identity for the Germans, English, Americans, and South Africans who welcomed them. For our Church, passing on the life of the Risen One means making our long history, pierced by the wounds of exile and exploitation, a living testimony to the resurrection of Christ, which cannot be contained within four walls or in wounds. It is a resurrection that is not limited to a story. It calls us to imitate Jesus, who on the very day of his resurrection in John’s Gospel does not delay his gift of new life but breathes it into his disciples and sends them forth. He immediately makes them participants in his new life and gives them the power to share it with others. The resurrection of Jesus, his peace, can open our hearts, our minds, our communities—here and now.
Like the first disciples, we are sent into the world after Jesus showed us the wounds on his risen body. Today we can serve in the world as envoys of the Risen One, without averting our gaze from his wounds, but without being fascinated, frightened, or trapped by them. This begins in our personal lives, continues in our nations, and is lived out today in our Church. In the years to come, we will have many opportunities to participate in this sharing of life that we receive when we look at the world through the wounds of Christ. I think of the preparation for the 400th anniversary, that of our 400 years of communion—and lack of communion… I also think of the many ways in which we can all ensure that the witness of Christ in our small part of the risen body of Christ continues for another 400 years: by ensuring that the Church today does not lack prayer, volunteers, or resources. Let us pray that Jesus will bless those who come to believe through our faithfulness in passing on, rediscovering, and implementing what we have received from him.